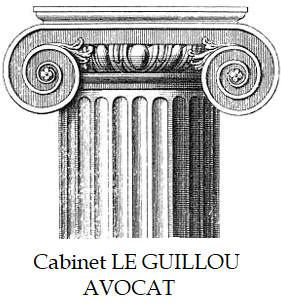Découvrez les actualités du cabinet Le GUILLOU Avocat à Quimper
ASSURANCES VIE
Bénéficiaire - assuré - souscripteur - Assureur : quand un contrat mélange les rôles...
01
Un contrat confus
Un grand-père contacte une compagnie d'assurance afin de souscrire une assurance-vie. Rien que de plus banal... Là où les choses se compliquent c'est que le contrat en question - sans doute rédigé "sur un malentendu " - prévoit que le grand-père est le souscripteur mais l'assuré est le petit-fils et le bénéficiaire est le père de ce dernier (de fait le fils du souscripteur)... vous me suivez toujours ?...
02
Un blocage...
La vie s'écoule paisiblement jusqu'au décès - nous sommes tous mortels - du grand-père.
Que devient le contrat ?
Le petit-fils prétend en solliciter l'exécution.
L'assureur s'y refuse, en effet, le petit-fils n'est que l'assuré, et l'assuré est tellement vivant qu'il se permet de réclamer de l'argent.
03
Un débat...
Ce sont les héritiers du grand-père, à savoir ses enfants qui vont devoir faire valoir leurs droits devant le Médiateur de l'Assurance. Ils se présentent comme héritiers et donc investis par la dévolution successorale dans les droits du défunt. La compagnie d'assurance s'y oppose violemment, arguant du caractère individuel du droit de rachat... Le souscripteur est mort c'est bien triste mais il ne peut donc plus racheter le contrat...
04
La médiation
Le Médiateur de l'Assurance dans sa sagesse donne raison aux héritiers du grand-père. Il rappelle que les héritiers ont le droit de prendre possession sans aucune formalité des biens du défunt et d'exercer ses droits.
Lorsque l'adhérent souscripteur décède et qu'il n'est pas l'assuré, le contrat d'assurance-vie n'est pas dénoué mais les droits qu'il pouvait exercer sur celui-ci sont automatiquement transmis à ses héritiers... Ils disposent donc du droit au rachat.
DROIT RURAL
LES TALUS BRETONS
01
Un peu d'ethnographie
Le paysage bocager de Bretagne est rythmé par ces levées de terre arborées que sont les talus.
En Breton, le talus se dit Kleuz (ar ar c’hleuz), substantif qui viendrait du vieux breton Clud (retranchement).
L’étymologie donne le ton, le talus est d’abord un symbole de propriété ou tout au moins de possession de droits.
Si le talus est un retranchement, il peut avoir plusieurs caractères : une levée de terre, une douve à son pied et un couronnement arboré. Entre les arbres et selon les endroits on plaçait en rempart contre les prédateur (dont le loup très présent en Bretagne) des tresses de ronces bien piquantes appelées « plesses » (d’où le toponyme de Plessis)
Le c’hleuz est donc indistinctement tout ça, ce qui explique des parfois des incompréhensions car traduit en français la levée de terre est appelée « fossé » et le «trou » à son pied est appelée la « douve »..
De tradition très ancienne (âge du fer, époque gallo-romaine), le « fossé » (appelons-le à la bretonne) se développe au moyen-âge lors des grands défrichements et après la révolution, lors de la disparition des terres communes dites vaines et vagues.
02
Un talus breton, ça ressemble à quoi ?
La particularité de ces clôtures rurales est qu’elles résistent (encore et toujours) à l’uniformisation. Leur forme, leur épaisseur, leur hauteur varie selon les usages, des arrondissements, des cantons et même parfois des paroisses.
De taille réduite à un mètre dans le canton de Pleyben, le fossé culmine à 6 pieds de haut (1m80) dans la région de Carhaix.
Dans certaines régions la douve est systématique, dans d’autres elle est absente.
Là où elle existe, la règle générale (là encore susceptible d’exception sans laquelle elle ne saurait être une règle) est d’attribuer au propriétaire du fossé (la levée de terre) la douve qui paradoxalement est du côté du voisin. L’adage « qui a fossé a douve » est connu de tout le monde rural.
Ceci parce que le propriétaire du talus va chercher dans la douve les pelletées de terre nécessaire à l’entretien et la consolidation de son ouvrage.
03
Qui a droit à quoi ?
J-M. LIMON, juge au tribunal de QUIMPER a rédigé un petit bijou d’ouvrage « Usages et règlements locaux en vigueur dans le département du Finistère » qui mêle réflexion juridiques et essai ethnographique de la ruralité bretonne du XIX ème siècle.
Il en retire qu’en règle générale la douve est un droit de propriété, elle-même frappée de tolérance dont le droit de gouzil qui autorise le voisin en limite de la douve d’y cueillir ou d’y ramasser herbes sauvages ou autres plantes pour nourrir ses animaux.
04
Et si vous en possédez un ?
Il est donc important de consacrer un peu de temps à établir par titre ou autre la propriété des clôtures rurales pour bien définir les lignes divisoires des propriétés.
Un avocat peut vous conseiller et engager avec vous une procédure de bornage amiable qui évitera des litiges en cas de vente de la propriété voisine.
ATTENTION ! Les problèmes juridiques liés au talus ne se résument pas à des revendications territoriales. Les autorités ont également leur mot à dire si la conservation des talus a été inscrite dans le marbre du PLU.
La destruction d’un talus (même au cœur de votre propriété si vous avez la chance d’en posséder aussi étendue) relève du tribunal Correctionnel !
.
.